Le Petit Journal, du 18 octobre 1865.
(source : gallica.bnf.fr)
LE CORPS DE CARTOUCHE Tous les journaux annoncent qu'on fait voir à Paris, pour un droit d'entrée de dix centimes, le véritable corps de Cartouche, le fameux bandit, mis à mort en 1721. Le même qui fit si longtemps trembler les Parisiens et qui fatigua de ses cascades messieurs les gens du roi.
On ne croirait pas, disent ceux qui ont dépensé leurs deux sous pour le voir, que le brigand est mort depuis cent quarante ans quand on considère ce corps momifié par l'embaumement, et qui a été conservé bien avant l'invention du procédé Gannal
(1).
Est-ce l'effet de l'imagination? Il semble, selon eux, que le crime a conservé son cachet sinistre sur ce visage pétrifié depuis un siècle et plus.
J'ai parlé de Cartouche à propos de la pièce de la Gaîté qui portait ce titre et dans laquelle son directeur actuel, M. Dumaine, représentait le célèbre voleur. Il y excellait surtout dans un travail de gymnastique qui faisait la joie des amphithéâtres.Il grimpait à la corde comme un chat et bravait les fusils des soldats du guet.
Je ne veux donc pas recommencer, aujourd'hui histoire de sa vie, mais bien celle de cadavre, tombé dans la baraque d'un spectacle forain.
On comprendrait qu'il fut facile de montrer le squelette de Cartouche. Mais son cadavre, c'est plus malaisé à croire, par la raison que le brigand fut roué, brisé, mis en capilotade en Grève.
Les directeurs d'exhibition affirment néanmoins que leur
sujet, est accompagné de papiers et documents attestant son incontestable authenticité.
Voici, dit
l'Epoque, d'après quelques recherches, par quel concours de circonstances ces restes d'un grand scélérat sont parvenus intacts jusqu'à nous. A la demande du confesseur de Cartouche, qui voulait lui épargner les terribles tortures de la roue, un des archers de l'exécuteur consentit, moyennant une bonne somme, à passer autour du cou du patient une corde fine soie, à l'aide de laquelle il l'étrangla sans que personne en vit rien.
Cartouche mort, on livra aussitôt son cadavre au valet du bourreau, avec ordre de l'inhumer immédiatement. Mais celui-ci jugea convenable de n'en rien faire et garda le corps plusieurs jours chez lui, l'exhibant aux Parisiens, moyennant un sol par tête, et ramassant ainsi de grosses sommes. Pour dissimuler l'odieux de cette dissimulation, il assurait que le produit de cette collecte était destiné à acheter un cercueil au supplicié, qui l'avait bien mérité par ses bons sentiments qu'il avait montrés à ses derniers moments.
Quand le corps commença à se corrompre, l'industrie le vendit au célèbre chirurgien de Saint-Côme
(2), qui l'embauma avec concours du docteur Lamare. Ensuite tous deux, aussi peu scrupuleux que le valet du bourreau, l'exposèrent et retirèrent un grand profit de cette exposition.
Le cadavre passa ensuite aux mains du professeur Brallouet qui en fit présent à l'Athénée royal lors de sa réception en 1761: En 1793, il fut dérobé à l'Athénée. En 1848, il était exposé une troisième fois aux regards du public. Acheté ensuite par un antiquaire de la rue de l'École-de-Médecine, il a été vendu par ce dernier 10,000 francs à celui qui l'exploite aujourd'hui.
Selon moi, il est facile de savoir si c'est bien le vrai Cartouche qu'on fait voir à la suite du
Phoque Savant et de la
Femme à barbe. Un écrivain expert en recherches judiciaires, M. Barthélémy Maurice, a consacré à Cartouche tout un volume rempli de détails inédits. Il suffirait d'examiner le Cartouche exposé avec le volume à la main pour être renseigné sur son degré d'authenticité.
Son auteur vous dira qu'on volait, qu'on assassinait dans les rues au temps de Louis XIV, mais que vers 1717, ces assassinats et ces vols décuplèrent tout à coup.
Un scélérat commandait deux mille coquins armés et prêts à tout faire. Ce coupable, qui semait la terreur dans la capitale, se nommait CARTOUCHE.
M. Barthélémy Maurice enlève tout d'abord à Cartouche son prestige de bel homme, de brigand d'opéra-comique, que Frederick Lemaitre lui avait imprimé quand il joua
Cartouche, au théâtre de l'Ambigu et que M. Dumaine lui conserva dans le
Cartouche de M. Dennery. Granval, un poète de ce temps et qui l'aura, bien vu, dit qu'il était
brun, sec, maigre, petit, mais grand par le courage. Il était si leste qu'il sautait, dans les rues étroites de ce temps, d'une maison à la maison en face par les toits ; il était de première force à l'épée, au bâton, au pistolet, et se grimait à ravir.
Les personnes qui voudront lire la véritable histoire de Cartouche n'ont qu'à prendre le livre de M.Barthélemy Meurice; ils le suivront dans toutes les phases de son existence aventureuse, tour à tour bohémien, soldat, bandit, amoureux, travesti sous tous les costumes.
Je me contenterai de reproduire ce qui regarde son arrestation, sa sentence et sa mort infamante.
L'arrestation de Cartouche se trouve rapportée dans le journal de Barbier :
« Il a été découvert tant par un vol qu'il a fait la nuit, chez un cabaretier, avec des femmes portant des hottes pour enlever des meubles, dont deux ont été prises et ont tout déclaré, que par un soldat de sa clique qui l'a vendu et livré. Ce soldat aux gardes méritait la roue et cependant était tranquille. Pacôme, aide-major des gardes, garçon adroit, qui savait qu'ils étaient de connaissance, fit prendre ce soldat pour le mener au Châtelet, pour son procès lui être fait, à moins qu'il ne voulût indiquer Cartouche. Il a consenti et a servi de
mouche.
» M. Le Blanc, secrétaire d'État de la guerre, qui s'est mêlé de cette recherche, en a chargé un des plus braves sergents aux gardes, qui a pris et choisi quarante soldats des plus déterminés et d'autres sergents avec lui. Ils avaient ordre de le prendre mort ou vif, c'est a dire de tirer sur lui s'il s'enfuyait.
» Cartouche s'était couché cette nuit-là sur les six heures, et il était couché dans un cabaret de la Courtille, dans le lit du maître, avec six pistolets sur sa table. On a investi la maison la baïonnette au bout du fusil. — Duval, commissaire du guet, y était aussi. On l'a pris dans son lit, heureusement sans coup férir, car il aurait tué quelqu'un.
» On l'a entouré de cordes ; on l'a conduit en carrosse chez M. Le Blanc, lequel ne l'a point vu, parce qu'il est dans son lit, indisposé, mais les frères de M. Le Blanc et le marquis de Tresnel son gendre, l'ont vu dans la cour, avec nombre d'officiers et de commis qui y étaient. On ordonné de le conduire au Châtelet à pied, afin que le peuple le vît et sût sa capture.
». Il était
habillé de noir, à cause du deuil de Mme la grande-duchesse, qui est morte il a quinze jours. »
Ce gueux qui porte un deuil de cour…, c'est un trait qui peint ce siècle élégant et vicieux.
L'arrêt de la cour qui le condamne est du 26 novembre 1721 et porte que Louis-Dominique Cartouche, dit
Lamarre, ou
Petit, ou
Bourguignon, est condamné à avoir les jambes, cuisses, bras et reins rompus vifs sur un échafaud qui, pour cet effet, sera dressé en la place de Grève. Cela fait, son corps mis sur une roue, la face tournée vers le ciel, pour y finir ses jours.
Le texte de l'arrêt, retrouvé par M. Barthélemy Maurice, finit par un
retentum, — on appelait ainsi le droit des cours souveraines d'adoucir la peine prononcée.
Ce retentum portait que ledit Cartouche serait secrètement étranglé après qu'il aurait été mis sur la roue… sans doute pour abréger ses souffrances, ce qui prouverait que ce n'était pas une complaisance du bourreau, mais bien la mise à exécution pure et simple de la sentence.
Elle fut exécutée en sa forme et tenue. Voilà qui établit parfaitement que Cartouche eut les os brisés.Comment a-t-on pu conserver ce corps mutilé ? C'est ce que j'ignore. Le montreur de curiosités qui était boulevard Saint-Martin n'avait logé son Cartouche que dans une boutique à louer, et qu'il occupait provisoirement.
Il était dans la destinée de Cartouche d'être nomade, vagabond, sans propriété à lui ; même cent-quarante-quatre ans après sa mort. La boutique, a été louée à un serrurier, que les restes de ce briseur de Verrous eussent inquiété.
Il est à l'heure qu'il est logé sur la grande place de Saint-Denis, afin d'être exhibé durant la fête de cette ville.
Mais M. Barthélémy Maurice vous dirait bien, en le voyant, si c'est là le bandit. Il a reçu, en son temps, la lettre suivante :
A M. B. MAURICE, HOMME DE LETTRES, PARIS.
Mon cher monsieur,
En réponse à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 18 du courant, je vous dirai que la bibliothèque de la ville de Saint-Germain-en-Laye possède, depuis le 25 avril 1849, le portrait en cire du fameux Cartouche dont vous allez publier la première biographie authentique. Ce portrait lui a été donné par l'abbé Niallier, héritier, sous bénéfice d'inventaire, de M. Richot, ancien officier de la maison du roi Louis XVI. M. Richot, décédé à Saint-Germain, possédait depuis plusieurs années ce portrait, d'autant plus précieux qu'il avait appartenu a la famine royale.
Ce buste en cire a été, d'ordre du Régent, moulé par un artiste florentin sur Cartouche quelques jours avant son supplice. Il est coiffé d'une toque de laine ou de feutre grossier, d'une chemise de grosse toile enduite de suie, d'un, gilet, d'une veste et d'un pourpoint de camelot noir. La tradition veut même que les cheveux, et la moustache aient été coupés sur le cadavre et recollés sur la cire. Le tout est renfermé dans un cadre en bois doré, large et profond, d'un fort joli travail ; on y remarque la tracé de l'écusson aux armes de France, ce qui atteste surabondamment son origine.
Sur la face externe, une glace de Venise protège le portrait. Le 17 janvier 1859, M. Nadar, dont l'Europe entière admire les travaux, a bien voulu reproduire, sous mes yeux, la photographie de ce monument réellement historique. Ce portrait, désormais impérissable, offrira un sujet d'étude curieuse aux phrénologues, aux peintres, ainsi qu'aux artistes dramatiques ?
Daignez agréer, monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus respectueux, EUGÈNE BUNOUT, bibliothécaire..
Entre le portrait de cire, que l'on retrouvera reproduit par la gravure dans le livre de mon excellent confrère, et le cadavre exhibé pour dix centimes au profit du public, il doit y avoir une comparaison facile. Les curieux la feront assurément.
TIMOTHÉE TRIMM
______________
(1) Procédé Ganal : Injection d'une solution de sulfate d'alumine dans la carotide. Mis au point par le pharmacien français Jean-Nicolas Gannal, au début de 1830. Il est le précurseur de l'embaumement moderne.
(2) Confrèrie de Saint-Côme : A l'époque, rassemble les chirurgiens de Paris.
 C
Condamnation à mort de Louis Dominique Cartouche et sept de ses complices (et non
six, comme indiqué précédemment ).
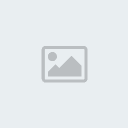
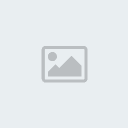
On remarque l'un des ses principaux lieutenants,
François-Louis Gruthus du Chatelet, qui le donna à la police.
Cet arrêt, signé AMIOT, est daté du
26 novembre 1721, veille de l'exécution prévue de Cartouche qui ne sera exécuté que le 28.
_______________
Dans son dictionnaire
Le droit criminel, le professeur Jean-Paul Doucet mentionne le
retentum de Cartouche :
Retentum au pied de L'arrêt :
A été arrêté que lesdits Cartouche et Gruthus du Chatelet seraient secrètement étranglés après qu'ils auront été mis sur la roue…Signé : Amelot - Signé Arnauld ».
Pour quelle raison Cartouche a-t-il bénéficié d'un
retentum ? On le comprend pour Gruthus du châtelet qui avait permis l'arrestation de Cartouche. Mais pour ce dernier ? À moins que son nom fût ajouté après qu'il eut livré des dizaines de noms de ses complices, le 27, jour où il devait être exécuté, ramené de la place de Grève ?
Aucun délai de temps n'est indiqué sur le
retentum de Cartouche et Grathus du Chatelet pour procéder à l'étranglement, après la mise sur la roue.
D'autres
retentum sont plus précis: ils mentionnent que le condamné, une fois posé sur la roue,
ne recevra aucun coup vif et sera secrètement étranglé, ou bien qu'il sera secrètement étranglé après avoir senti
trois coups vifs.
Dans l'ouvrage
Histoire de la vie et du procès du fameux Louis Dominique Cartouche, et plusieurs de ses complices., Lille, 1722 (dont Thimotée Trimm a puisé nombre de renseignements pour son article), on lit :
«
Alors on le conduisit à la Grève, où il reçut onze coups vif, il fut ensuite exposé sur la roue pour y expirer, comme la sentence le portait, mais une demie heure après un Valet, à la prière de son confesseur, tira par dessous l'échafaud une corde que Cartouche avait au col, il fut étranglé sans que personne n'en vit rien».
François-Louis Gruthus du Chatelet.
Porté sur la condamnation à mort du Parlement de Paris, Gruthus n'a pas été exécuté ! Dans le
Dictionnaire critique de biographie et d'histoire (1872, deuxième édition), d'Auguste Jal, on lit avec étonnement :
«
Une des pièces du procès de Cartouche me fait connaitre que, pendant l'épreuve de la question, Rozy * fit des révélations qui, le 17 mai, portèrent M. Joly de Fleury, procureur général, à faire arrêter François-Louis Grathus du Châtelet, condamné à mort par l'arrêt du 26 nov.1721, mais à qui la trahison envers Cartouche, qu'il avait livré, avait valu une commutation de peine (Arch.de l'Emp. et arc. de police).
* Rozy François Jean-Baptiste : dit le chevalier Le Craqueur. Un des affiliés de Cartouche.
Exécuté place de Grève le 10 juin 1722.
Le 23 août 1720, à Paris, il avait assassiné avec deux complices, pour le voler, le poète Jacques Viguier.
___________________________
Exemples de
retentum (cités par
Pascal Julien) :
« Arrêté que ledit Jean-Claude Ponchon sera secrettement étranglé après être resté une heure sur la petite roue » (18-01-17- 1785).
« Arrêté que le dit Étienne Vinloy ne recevra aucun coup vif et sera secrettement étranglé sur la croix de Saint-André » (07-02-1755).
« Arrêté que le dit Bernard de la Fosse sera secrètement étranglé après avoir senti trois coups vifs» (04-12-1755).
Il s'avère cependant que l'étranglement voulu secret ne pouvait pas toujours le rester. En effet, Pascal Julien fait observer que le
libraire Hardy qui assista à plusieurs exécutions capitales, et qui tint un journal où il les consigna, mentionne la visibilité des étranglements. Un des plus remarqués fut celui de
Louis-Jacques Boucher en
1780 (ligoté sur la roue), qui nécessita l'action commune, et à grand-peine, de trois exécuteurs.
En plus de l'étranglement manuel pratiqué par l'exécuteur, un curieux dispositif, peu connu, permettait d'abréger l'exécution du condamné. Il a été décrit par le juriste
Muyart de Vouglans (l'orthographe de quelques mots a été modernisée) :
«
Quand le patient ne doit pas être rompu vif, suivant le retentum porté par l'arrêt, on a précédemment construit sous l'échafaud, à l'endroit où le patient à la tête, un moulinet composé de deux montants arrêtés en haut sous l'échafaud, et en bas sous la terre, que deux traverses assemblent ; et au milieu est le moulinet rond, percé de trous, comme on le voit derrière les charrettes et charriots, et une corde passée en cravate sur le cou du criminel, se va se rendre à ce moulinet ; se roulant autour par moyen des leviers, que deux hommes abaissent l'un après l'autre, elle serre progressivement le cou du patient, et l'étrangle sur le champ ».
Après l'expédition faite, le corps du criminel est porté sur une petite roue de carrosse, dont on a scié le moyeu en dehors, et qui est placé horizontalement sur un pivot. L'exécuteur, après lui avoir plié les cuisses en dessous, de façon que ses talons touchent au derrière de la tête, l'attache à cette roue en le liant de toutes parts aux jantes, et le laisse ainsi exposé au public, plus ou moins de temps, quelquefois on l'expose ainsi sur un grand chemin, où on le laisse pour toujours. Pascal Bastien, dans son étude sur les exécutions publiques souligne que sur un échantillon de
23 condamnés au supplice de la roue,
16 avaient "bénéficié" d'un
retentum.
Dans le cas où le condamné n'en bénéficiait pas, il lui restait la possibilité d'un abrègement de la durée de son supplice, sur décision du lieutenant-criminel du Châtelet. Ce lieutenant présidait l'exécution capitale et détenait le pouvoir d'ordonner le coup de grâce. Par exemple à la suite des supplications du condamné. En outre, même en cas de
retentum, le lieutenant-criminel pouvait encore abréger le délai mentionné sur ce dernier.
C'est également le lieutenant-criminel qui déterminait le trajet devant être effectué par le condamné, de son lieu de détention au lieu d'exécution. Il pouvait aussi le modifier à son gré si un évènement quelconque survenait, risquant de troubler l'ordre publique par exemple.
L'heure de l'exécution capitale était fixée par ce même lieutenant-criminel (en général l'après-midi à cette époque), et il avait toute autorité pour la modifier en considération des motifs laissés à sa seule appréciation.
Un exemple surprenant a été rapporté par le magistrat Thomas Gaulette, témoin de l'exécution de
Mauriat, décapité le
15-09-1738 pour viol (archives nationales ADIII6, décembre 1738).
Source :
Pascal Bastien.
«
Le condamné Mauriat avait instamment demandé au lieutenant-criminel du Châtelet s'il était possible de « lui épargner du moins la honte d'être vu au grand jour» lors de son exécution.» S'adressant au bourreau, le Lieutenant-criminel s'informa de la possibilité d'une exécution aux flambeaux ! Sur la réponse affirmative de l'exécuteur, le lieutenant-criminel reporta l'exécution à la nuit. Elle se déroula place de Grève (aujourd'hui, place de l'Hôtel-de-Ville), à la lueur de soixante flambeaux ». _______________________
Pascal Bastien L'Exécution publique à Paris, au XVIIIème siècle - Une histoire des erreurs judiciaires, éditions Champ Wallon (collection Époques), Seyssel (01420), 2006.
Muyart de Vouglans Pierre-François Les loix criminelles en France, dans leur ordre naturel, Mérigot et Morin, Paris, 1780.
*
Juriste et avocat, Muyart de Vouglans trouvait une pleine justification aux tortures et supplices infligés aux prévenus et était partisan de la peine demort. A noter qu'il avait relevé, avec d'autres avocats, les vices de procédure, les infractions à la loi, etc. entachant la sentence de mort prononcé contre le
Chevalier de la Barre par les juges d'Abeville. Le Chevalier avait été condamné à avoir la langue et le poing coupés, la tête tranchée, et le corps réduit en cendres dans un « bûcher ardent » pour avoir refusé de se découvrir devant le Saint-Sacrement, proféré des blasphèmes, commis des actes sacrilèges, etc. Il fut décapité le 1er juillet 1766, à Abbeville (Somme), par le bourreau de Paris, Charles-Henri Sanson. La convention le réhabilita.
